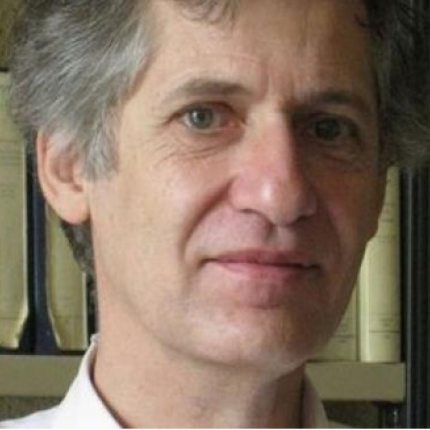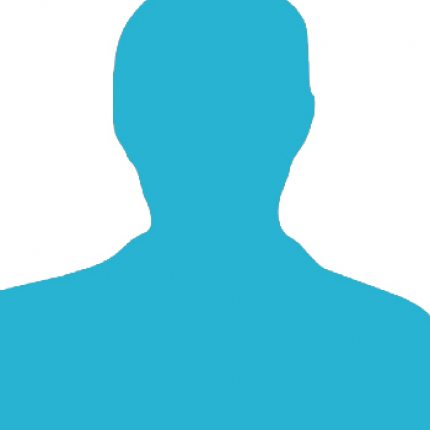Imaginons que nous ouvrons un évangile pour la première fois (par exemple l’évangile de Luc) et que nous essayons de pratiquer une méthode de lecture rapide qui consiste, dans un premier temps, à ne regarder que le début de chaque paragraphe. On constate aussitôt qu’il est toujours question d’un homme appelé Jésus, et que cet homme ne tient pas en place.
Voyez plutôt : «il vint à Nazareth», «il descendit à Capharnaüm», «il entra dans la maison de Simon», «il traversait des champs de blé», «il entra dans la synagogue», «il s’en alla dans la montagne pour prier», «il se rendit dans une ville appelée Naïn», «il faisait route à travers villes et villages», «il monta en barque avec ses disciples», «ils abordèrent au pays des Gergéséniens», «à son retour, il fut accueilli par la foule», «il prit résolument la route de Jérusalem», etc.
Bref, ouvrez deux pages d’un évangile : il y a fort à parier que Jésus, de l’une à l’autre, à au moins changé trois fois d’endroit ! Que de va-et-vient ! que de mouvements ! que de kilomètres parcourus en quelques pages ! Et voici encore le texte qui vient d’être lu : «Comme ils étaient en route, quelqu’un dit à Jésus en chemin : ‘Je te suivrai partout où tu iras.’» Est-ce que l’inconnu qui prononça ces mots savait vraiment de quoi il parlait ? Est-ce qu’il avait vraiment réalisé qu’il s’adressait à un homme qui marche tout le temps ? Est-ce qu’il avait compris que Jésus, prenant résolument la route de Jérusalem (comme l’écrit Luc), se dirigeait vers la croix où il allait mourir ? Nous n’en savons rien, après tout, mais la réponse de Jésus a dû refroidir son ardeur : «Jésus lui dit : ‘les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids ; le Fils de l’homme, lui, n’a pas où poser la tête.»
Ce Jésus, toujours en chemin, apparaît bel et bien comme un homme sans domicile fixe. C’est tout le contraire d’un professeur qui donnerait ses cours sa vie durant dans la même salle, d’un dispensateur de science vers lequel on viendrait s’instruire, d’un distributeur de réponses qu’on saurait toujours où trouver. Non : Jésus n’est jamais là où on l’attend. Regardez les renards ou les oiseaux : les amoureux de la nature et autres naturalistes savent bien que pour observer des animaux sauvages, il est parfois utile de repérer les traces de leur terrier ou de leur tanière; et les ornithologues ont l’oeil pour découvrir, caché dans des roseaux ou en haut d’un arbre, un nid vers lequel ils vont orienter leurs jumelles. Parce qu’on sait bien qu’il y a des chances d’apercevoir à cet endroit ces animaux qu’on voudrait observer. Eh bien, pour observer Jésus, c’est tout différent : on croit le trouver à tel endroit, et il n’y est pas toujours; on ne s’attend pas à le trouver au détour d’une situation, et le voilà qui survient.
Le renardeau dans son terrier et l’oisillon dans son nid vivent dans une relative sécurité. Rien de tel pour Jésus : il marche sur les routes, suivi d’une petite troupe de farfelus, dont certains sont idéalistes, d’autres désabusés, d’autres peut-être pas très malins, il annonce partout où il passe que le royaume de Dieu s’est approché, il rencontre des gens, il écoute les souffrances des gens, il les guérit parfois, il les nourrit, mais il n’a aucune sécurité de l’emploi. Jésus, le fils du charpentier Joseph, n’a pas de «situation». Encore une fois, il n’a pas même de domicile fixe.
Alors, suivre Jésus, n’est-ce pas un peu présomptueux ? Peut-on vraiment, sur un coup de coeur, dire à un tel homme : «je te suivrai partout», parce que l’une de ses paroles nous a soudain touchés ? Peut-on prétendre le suivre sans avoir réellement compris à quoi on s’engageait ?
Une chose est sûre. Suivre Jésus, c’est s’exposer à un choc. Le choc de la déstabilisation. Impossible de se mettre à sa suite, sans qu’il y ait, dans son existence, de changement. Impossible de le suivre sans être soi-même en mouvement, sans accepter le risque d’une marche en avant qui nous conduira peut-être là où l’on ne pensait pas, sans accepter d’être délogé de ces idées toutes faites dont nous sommes pétris.
Il y a là quelqu’un qui veut suivre Jésus, sans bien se rendre compte qu’il devra perdre quelque chose de sa sécurité matérielle. Et Jésus le met en garde : attention ! suivre celui qui n’a pas de lieu où poser sa tête, c’est se mettre en mouvement, c’est accepter de perdre son confort, ses attaches. Tel autre veut bien suivre Jésus, mais il met en avant le respect des rites funéraires et sociaux – et paraît opposer les deux choses. Et Jésus lui montre (avec ces mots si cruels : «Laisse les morts enterrer leurs morts») que l’annonce du Royaume ne laisse dans l’ombre aucune activité de l’existence humaine. Tel autre enfin veut aller faire ses adieux à sa famille – là encore, c’est comme s’il opposait suivre Jésus et garder de l’affection pour les siens. Et Jésus lui demande de ne pas se retourner en arrière. Dans ces trois cas, il y a le choc de la déstabilisation. Un choc vécu chaque fois différemment... et que tous ne sont évidemment pas appelés à vivre de cette façon-là précisément, mais un choc inévitable.
Les personnes qui se disent non croyantes ont parfois d’étranges idées à propos de celles qui (comme on dit dans le langage courant) «ont» la foi. On entend parfois des réactions comme : «Moi, je n’ai pas la chance d’avoir la foi : j’aimerais bien croire comme vous, mais il y a trop de choses que je n’arrive pas à comprendre. Et d’abord : pourquoi tant de violence, tant de guerres, pourquoi la haine, pourquoi la souffrance ? Non : impossible de croire dans ces conditions. Il faudrait d’abord qu’on m’explique pourquoi il y a le mal.»
Une réaction comme celle-là est assez fréquente. On peut comprendre ce qui la motive extérieurement et, après tout, je ne suis pas loin de penser que certains d’entre nous, dans ce temple ou devant leur poste de radio, seraient assez prêts à faire leur cette réaction. Seulement voilà : je crois qu’une telle réaction part d’une idée complètement fausse de ce qu’est un croyant, comme si un croyant était quelqu’un qui a tout compris, qui sait à peu près tout des choses de Dieu, qui a trouvé la réponse (au moins intérieure) au problème du mal.
Or, le chrétien ou la chrétienne, ça n’est précisément pas celui ou celle qui a tout compris ou qui sait tout, mais celui ou celle qui s’est mis en chemin à la suite du Christ. C’est tout différent. Car pour se mettre en chemin, il ne faut pas avoir acquis un bagage intellectuel qui nous permettrait de répondre à toutes les questions que pose l’existence humaine; il faut entrer dans une relation de confiance avec celui qu’on accepte de suivre. Les auditeurs qui ont entendu les cultes du temple d’Aubonne, ces derniers dimanches, se rappellent peut-être qu’il a été question de confiance. La confiance, c’est aussi accepter d’avancer vers quelqu’un, un peu comme le petit enfant qui fait ses premiers pas, en titubant, en direction de sa mère ou de son père... sans savoir très bien s’il parviendra à rester debout sur ses jambes ou s’il perdra tout à coup l’équilibre.
Car la marche, vous le savez, c’est toujours un peu risqué. La seule façon d’être sûr de ne jamais tomber, de ne jamais perdre l’équilibre, c’est de se coucher par terre. Les résultats sont garantis. Le problème, c’est qu’on ne va jamais très loin quand on se couche par terre.
Quand nous marchons, à chaque pas nous perdons un instant l’équilibre; mais sans cette perte passagère d’équilibre, il n’y a aucune avance possible. Le phénomène de la marche est fascinant, et on comprend que Giacometti ait tenté de le percer par ses sculptures, comme celle du marcheur qu’on voit maintenant sur nos billets de 100 francs.
Marcher. Abraham n’a pas fait autre chose, lui qui s’est mis en chemin à l’appel de Dieu, sans savoir très bien où il allait. Et ce n’est pas pour rien qu’on appelait parfois les premiers chrétiens (par exemple dans le livre des Actes) les «adeptes de la voie» (on aimerait traduire : «les mordus du chemin»)… Abraham, comme les premiers disciples de Jésus : voilà des hommes, des femmes qui sont loin d’avoir la réponse à toutes leurs questions, mais qui acceptent de se mettre en route
J’aimerais encore vous parler d’André. André, c’était un ami. Oh, nous sommes très nombreux à Genève et ailleurs à pouvoir parler de lui en ces termes. Je veux parler d’André Fol. Il était prêtre catholique romain. Depuis plusieurs années, il souffrait le calvaire (ce mot affreux qui rime avec cancer). André est mort cette semaine. Et l’image qui me vient en pensant à lui, c’est celle d’un marcheur de Dieu.
Il y a deux ans, André Fol avait publié des extraits de son journal de malade : Temps de crise, temps de croire ? Un titre étrange, apparemment, mais qui montre bien cette conviction qui habitait André Fol : de même que la marche n’exclut pas le déséquilibre, la foi n’exclut pas la crise. Le croyant, ça n’est pas celui qui a réponse à tout, et André Fol répétait souvent, avec son humour qui nous a si souvent fait comprendre les choses les plus importantes de la vie, que lorsqu’il se trouverait en présence de Dieu, il aurait ce jour-là quelques questions à lui poser.
Peut-être qu’il les lui pose aujourd’hui, ces questions qui l’ont habité tout au long de sa vie et particulièrement ces dernières années. Mais c’est une affaire entre Dieu et lui. Entre Dieu et nous, aujourd’hui, il y a une autre affaire. Dieu, en Jésus-Christ, nous invite à le suivre – sans répondre par avance à toutes nos questions. Comme celle des premiers disciples, notre marche est hasardeuse, nous perdons souvent l’équilibre.
Surtout, n’arrêtons pas de poser des questions. Ne cessons pas de nous laisser déloger de nos principes sécurisants et de nos idées toutes faites. Acceptons de nous remettre en question. C’est là le prix de ce chemin à parcourir avec Jésus. Et si nous trébuchons un peu, si nous perdons l’équilibre, peu importe après tout. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin puisque Dieu lui-même marche avec nous.
Amen.